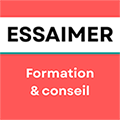Marilyn Baldeck
Diplômée en sciences sociales et politiques de l’Institut Français de Presse, Marilyn Baldeck a finalement trouvé dans le droit son outil de prédilection. Pendant 15 ans elle a contribué, dans le milieu associatif, aux procédures judiciaires qui ont forgé la jurisprudence relative au harcèlement sexuel. Elle a initié ou participé aux principales réformes législatives sur le sujet au cours des deux dernières décennies.
En mars 2024, elle crée ESSAIMER pour porter collectivement les projets qu’on lui confie, et pour continuer à diffuser ce que le soutien aux victimes – qui reste le cœur de son engagement, notamment au sein de La Collective Des Droits – lui apprend au fil du temps.
Marilyn Baldeck intervient dans plusieurs cursus universitaires et formations professionnelles, notamment :
- le Diplôme Universitaire Violences faites aux femmes de l’Université Paris 8,
- le certificat de spécialisation en psychopathologie du travail de l’Institut de Psychodynamique du Travail de Paris,
- le Master 2 de médecine légale et sociale et le DU Violence et santé de l’Université Sorbonne Paris Nord,
- la formation de direction d’exploitation cinématographique de la FEMIS.
- la formation management de production de l’école ARTFX, schools of digital arts
Léa Scarpel
Léa Scarpel a roulé sa bosse pendant 15 ans dans la protection des droits fondamentaux, en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes, au Mexique, en Inde, en Espagne, à Bruxelles, dans la région Euro-méditerranéenne, pour le compte d’ONG ou d’institutions internationales.
Revenue en France en 2018, elle a d’abord été formatrice sur les violences conjugales, puis juriste à l’AVFT, où elle a pu, pendant 7 ans, frotter son parcours d’historienne et de juriste en droit international au contact de ce terrain. Si elle peut se déplacer partout, elle couvre plus particulièrement les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA pour Essaimer.


Clarisse Feletin
Titulaire d’une maîtrise de droit, diplômée de Science Po Paris et du Centre de Formation des Journalistes, Clarisse Feletin a d’abord mis sa passion pour l’investigation et la documentation du réel au service de l’information. Réalisatrice de documentaires multiprimée, elle s’est intéressée à la question du harcèlement sexuel au travail bien avant Metoo, en réalisant en 2012 un documentaire pour France 2 intitulé “sexe, mensonges et harcèlement”.
Elle a par la suite documenté le cas des violences sexistes et sexuelles dans le secteur du nettoyage industriel en sous-traitance et a réalisé un court-métrage de prévention des VSS dans le milieu du cinéma pour le CNC.
Rompue aux techniques d’enquête (entretiens, procédure sérieuse, contradictoire, impartiale et indépendante), elle se sert de son expérience de terrain pour mener des enquêtes internes au sein des entreprises conformément au cadre réglementaire attendu en la matière.
Maude Beckers
Maude Beckers est avocate depuis 25 ans. Spécialisée en droit du travail et de la discrimination au travail, elle a fait de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail et les discriminations le cœur de son activité, en défense des victimes, ou comme conseil des employeurs… si et seulement s’ils ont réellement décidé de faire de la lutte contre ces violences une pierre angulaire de leur politique d’entreprise.
Convaincue que le combat doit passer prioritairement par la prévention, Maude Beckers est également formatrice et assure à ce titre des interventions auprès de divers publics.
Enfin, pour que les cas de violences sexistes et sexuelles se règlent rapidement et efficacement, et afin de préserver les droits des personnes impliquées mais également le climat social, elle a développé depuis plusieurs années une activité d’enquêtrice permettant aux structures confrontées à ces situations de déléguer une mission souvent difficile à réaliser en interne.

En fonction des projets, ESSAIMER coopère avec d’autres cabinets experts
et des consultant.es indépendant.es